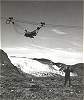L'expédition de 1948 fut une Campagne préparatoire
qui fut riche d'enseignements dans de nombreux domaines et en
particulier dans celui du transport. Les 110 tonnes de matériel
débarqués du " Force " mirent hommes
et matériel à dure épreuve. Cinq Weasels
composaient le parc de l'expédition plus deux de réserve.
Malheureusement un des véhicules de réserve coula
lors du débarquement et ne put être renfloué.
La topographie du site obligea l'utilisation d'un téléphérique,
heureusement prévu par Michel Perrez pour vaincre un
passage particulièrement difficile et dangereux à
8 km du camp I.
Une falaise de 110 m de dénivellation que les véhicules
durent, allégés au maximum, contourner pour atteindre
l'Inlandsis. Mais les difficultés n'étaient pas
terminées et la poursuite du cheminement fût dure
et laborieuse.
Enfin le 25 juillet, 46 jours après le débarquement,
les membres de l'Expédition, qui avaient travaillé
quatorze heures par jour en moyenne purent enfin prendre une
journée de repos.
Une reconnaissance appuyée de deux Weasels progressa
difficilement dans un dédale chaotique de crevasses,
de bédières, de glace fondante, tantôt dans
le brouillard, sous la pluie, sans aucune visibilité.
Il fût décidé de stopper la progression
et de stocker le matériel pour l'année suivante.
Il faut malgré tout souligner que parallèlement
à cette activité, les travaux scientifiques furent
menées à bien. Le 22 septembre toute l'équipe
embarquait sur le " Brandall " qui arriva le 13 octobre
à Rouen. La première modification qui en découla
fût le recrutement d'une équipe technique qualifiée
plus importante. |
|


M29C en difficulté - Paul Emile Victor écope -
Les deux gouvernails sont levés. |
Voir l'article de Paul-Emile
Victor publié en 1948 >>>

Campement provisoire |
|
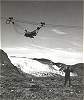
Téléphérique mise en place
par Michel Perrez |
|

Installation d'une station météo.
automatique |

Forage glaciologique |
Le but de cette campagne est l'édification de la base
" Station Centrale " où vont hiverner 8 hommes.
Fort de l'expérience passée l'expédition
embarque à Rouen sur le " Fejellberg " un mois
plus tôt, le 13 avril 1949. Le 27 mai le bateau arrive
dans la baie De Quervain. Aussitôt quinze hommes rouvrent
les Camps I et III. Les véhicules aussitôt sollicités
se mettent en marche malgré un stockage de 8 mois sous
des températures descendant à -40°. Puis débute
l'acheminement du matériel. Il n'y a pas de temps à
perdre car la fonte commence son oeuvre et risque de compromettre
toute la mission. Un incessant va et vient début pour
acheminer tout le matériel au delà de la zone
d'ablation et rendue impraticable par le dégel. Deux
groupes sont formés.
Le premier fonce sur le point où " Station Centrale
" et y débuter les travaux d'implantations sans
oublier les travaux scientifiques. Le second groupe est chargé
d'acheminer le matériel et d'effectuer les recherches
scientifiques. Un va et vient là encore se met en place
quelques fois sans interruption et allant jusqu'à vingt
huit heures de travail acharné, le dernier atteignant
soixante et une heures !
Mais commence aussi le début des pannes et principalement
sur les chenilles. Trop sollicitées l'année précédente
c'est six chenilles qui cassent après 110 km puis 70
km plus loin, le 5 juillet c'est encore huit nouvelles pannes
de chenilles. Les réparations demandent d'énormes
efforts et prennent beaucoup de temps. C'est un véritable
travaille de " petites mains " qu'accomplissent les
mécaniciens, par -25° mains nues. Devant cette situation
un parachutage prématuré est enclenché.
(Lire: 1er parachutage
au Groenland)
Le 13 juillet le convoi reçoit vivres, carburant et surtout
des chenilles. Le convoi repart le 15 et arrive au point de
" Station Centrale " le 16 juillet. Celle-ci est implanté
par 70°54 N et 40°42 W. Rappelons que la la Station
d'Alfred Wegener " Eismitte " 1930.1931 (voir
article Wegener) est à 70°53'8 et 40°42'1W.
Enfouie dans le névé, la station mesure 5m x 8m
et 2m de hauteur. Le 14 août 1949 la station est terminée,
les travaux de recherches accomplis. Les huit hommes sont "abandonner".
Citons et saluons ces hommes qui sont les premiers français
à hiverner sur le glacier du Groenland, enfouie dans
la neige, durant l'hiver boréal, avec des températures
qui descendront à -66°, et ce durant 11 mois.
L'hivernage se déroula dans conditions particulièrement
difficiles :
| - Enneigement journalier des ouvertures |
|
- Défaillance des groupes électrogènes |
| - Températures extérieure très
bases - 66° et blizzard |
|
- Dysfonctionnement des appareils de mesure et de radio |
| - Ventilation des locaux difficile |
|
- Monotonie des rations alimentaires |
| - Vie à 3000 m d'altitude |
|
Durant l'hivernage les véhicules furent très
peu utilisés |
|
|

Weasel M 29 C - La tempête lui a
sculpté des dentelles de glaces.
Photo JJ Languepin - |
| |

Passage d'une rivère sur l'Ice Cap
-1949 - Photo Bougouin |
| |

Weasel M29C en direction
de la Station Centrale.
Remarquez la faible pression au sol (140 gr/cm²)
Photo E.P.F. - 1949
Collection G. Gadioux © |
|
Les hivernants :
| Chef d'hivernage : Robert Guillard |
|
|
| Adjoint et Chef Météo : Michel Bouché |
|
Météo : Pierre Chavy et René Garcia |
| Radio : Lucien Bertrand |
|
Mécanicien : Camille Marinier |
| Médecin-chirurgien : Dr Marcel Carles |
|
Physicien : Gérald Taylor |
|
 |
|
Hivernage 1950-51
Plan d'ensemble sous la surface |
|
|
| |
|
|
|
|
1 Salle commune - habitation
2 Laboratoire de météorologie
3 Cabine de météorologie physique atmosphérique
4 Soute à radio sondes
5 matériel radio
6 Soute à hydrogène
7 Cabine de radiotélégraphie
8 Soute à matériel radio
|
9 Soute à batteries
d'accumulateurs
10 Ancien abri des moteurs
11 Soutes à carburant
12 Alvéoles à vivre
13 Laboratoire annexe de glaciologie-météorologie
14 Lab. de glaciologie
15 Puits de glaciologie
|
16 Sortie - air de
lancement radio sonde
17 Ancienne sortie
18 sortie S.-O.
19 soutes d'intendance et de médecin
20 Ancien laboratoire de photographie
21 Couchettes superposées
22 Cabinet de toilette |
23 Couloir à
ordures et W-C
24 Couchettes supplémentaires
25 Soute à neige
26 Puits d'éclairage
27 Salle des machines
28 ancien trou à ordures
---- Transformations
apportées |
A lire : Station Centrale de Michel BOUCHE chez Grasset 1952
Le nombre de participants passe de 35 à 42 pour cette nouvelle
campagne qui embarque à Rouen le 13 avril 1950 sur le navire
norvégien le " Hillevaag ".
Suite à une rupture d'hélice, l'expédition
fût transbordée sur le " Force " après
une escale de 20 jour dans le fjord d'Ivgtut. Dès le 28 mai,
malgré la présence de glace dans la baie de Quervain
les travaux reprennent. Les différents camps sont ouvert.
Le débarquement est effectif le 6 juin. La même stratégie
est employée, deux groupes sont constitués. Le groupe
A spécifiquement scientifique et le groupe B groupe de transport.
Le groupe A débute ses travaux le 8 juin. Le 20 il se dirige
vers " Station Centrale " qu'il atteint le 1er juillet.
Les travaux scientifiques et de logistiques ne connurent peu ou
pas d'entraves au bout déroulement ce qui permis de poursuivre
vers la côte Est. A signaler qu'une partie de l'équipe
d'hivernants de 1949 est évacuée par cet axe.
Depuis Cécilia Nunatack les hommes sous la direction de Robert
Guillard vont marcher durant trois longues journées dans
une zone montagneuse et rocailleuse. La marche est épuisante
sur un itinéraire inconnue dans la pluie, le brouillard et
le froid. Ils atteignent le fjord de Rôhss le 4 août.
Un bateau les attends et les achemine jusqu'à Ell Ô.
Là un hydravion islandais les transporte jusqu'en Islande.
La campagne se déroule sans soucis majeur. Le retour sur
Camp I pose des problèmes dû à la fonte et son
cortège de conséquences.
Enfin après une importante et salvatrice chute de neige,
l'ensemble des hommes et du matériel sont regroupés
le 2 octobre au camp I après un parcours pénible et
périlleux. Le 6 octobre le " Polarbjörn "
évacue la mission vers la France qu'il atteint le 24 octobre.
A la " Station Centrale " neuf homme débutent leur
hivernage.
Les hivernants :
Paul Voguet - Chef d'hivernage
Dr Robert Gressard - Chef assistant Médecin Chirurgien.
Bernard Bedel - Chef Météo.
Pierre Dill - Météo.
Bernard Gaillard - Assistant météo. |
|
Bernard Isabelle - Assistant météo.
Jean Dumont - Électricien et glaciologue.
François Daumas - Chef Radio.
Robert Lassus - Radio |
|
Cette campagne a pour objectif, la poursuite et l'intensification
des mesures scientifiques et le rapatriement des 9 hivernants.
Le départ de Rouen à bord du " Skallabjôrn
" se déroule le 22 avril 1951. Comme à la coutumée,
des mesures scientifiques sont effectuées tout au long du
trajet et en particulier les mesures gravimétriques. Le bateau
arrive à Port Victor le 25 mai.
Rapidement les 13 weasels sont déstockés et l'ensemble
des 22 participants quitte Camp I et atteint Camp VI le 3 juin.
Ce camp rappelons le se situe après la zone de fonte, des
bédières et autres crevasses. Après un ravitaillement
aérien, quatre groupes sont constitués. Une fois encore
du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est les groupes vont parcourir
de nombreux kilomètres et assurer le programme. Un groupe
de séismiques ira jusqu'à 930km au Sud de Camp VI.
Ce même groupe se dirige vers l'Est et remonte en direction
du Mt Forel. Après plus de 900 km, le 4 août 1951 le
véhicule de tête conduit par Alain Joset, chef de groupe
de la section séismique avec à ses cotés, Jens
Jarl représentant du Gouvernement Danois, passe sur une crevasse
invisible, le pont de neige cède. Le véhicule et ses
deux occupants font une chute mortel de plus de 40 mètres
( voir
l'article du site du centre PEV ).
Malgré ce dramatique événement la mission se
poursuit. Les travaux scientifiques se poursuivent sur tout les
axes . Le point faible des véhicules est les chenilles. Un
véhicule doit être mis sur un traîneau faute
de chenilles de rechange et en attendant les parachutages.
Sur la côte Est le cheminement est particulièrement
difficile. Le véhicule de tête défonce à
six reprises des ponts de neige, mais a pu à chaque fois
être sorti sans dommage. Le 23 août " Station Centrale
" est évacuée et fermée en état
au cas ou elle devrait être utilisée. Sur la route
du retour vers Camp I nombreux incidents dû comme toujours
à la fonte. Le 26 septembre le " Polar Star " appareille
avec à son bord l'ensemble de l'expédition.
| Travaux en Islande de 1950.
1951.1955 : |
|
Il faut signaler que plusieurs missions motorisées
se sont déroulées en Islande.
Misions de Géologie, Gravimétrie, Sondages Séismiques
auxquelles participèrent quatre membres de E P F et six Islandais.
Deux Weasels ont permis malgré un terrain très difficile
d'accomplir les divers programmes.
En 1952, Paul-Emile Victor, passe un accord avec les Forces Militaires
Américaines installées à Thulé pour
effectuer à partir de leur base un raid de traversée
de l'extrême nord du Groenland. La mission est confiée
à Robert Guillard qui va effectuer avec son équipe
un raid d'environ 2000 km.
De Thulé à la Terre de Peary. Les véhicules
et toute la logistique sont fournis par les USA.
A lire absolument: au-delà de THULE de Robert POMMIER chez
Amiot. Dumont 1953
Les différents convois sont supportés par une présence
aérienne et bénéficient de ravitaillements
par largages aériens de matériels et d'essence.
Le savoir-faire logistique français va permettre aux scientifiques
d'avancer sur la connaissance de la masse de l'inlandsis groenlandais
et l'approfondissement des mesures glaciologiques.
| E.G.I.G - Expédition
Glaciologique Internationale au Groenland : |
|
A partir de 1959 et jusqu'en 1974, un partenariat avec l'Allemagne,
l'Autriche, le Danemark et la Suisse va permettre la poursuite des
premières études, la France assurant les moyens logistiques.
Jusqu'à 13 Weasels MC 29 C et 5 HB 40 Castors sont utilisés
tractant 8 caravanes , 13 traîneaux et 1 chambre frigorifique.
Le support aérien assuré par deux Nord 2501 de l'armée
de l'Air Françaises et deux hélicoptères Alouette
II. Au court de ces différents raids Peu de pannes importantes.
Les diverses modifications portent leurs fruits. Les chenilles ne
cassent plus, seuls quelques rivets, fragilisés par les températures
négatives cassent. Quelques ennuis au niveau des barbotins
et des poulies de tensions.
La neige pulvérisée pénètre sous les bandes
de caoutchouc vulcanisées sur ces pièces et se transforme
en glace. Ce phénomène décolle les bandes et
oblige le remplacement de ces pièces mobiles. Des échanges
de moteurs ont été nécessaire pour la plus part
suite à un défaut de conduite plus que par défaillance
mécanique. Un autre critère non négligeable est
le manque de pièces détachées obligeant le service
techniques à utiliser des organes et pièces maîtresse
à la limite de la résistance.
 |
Deux Weasels M 29
C progressent sur la zone marginale pour atteindre l'Inlandsis.
Une caravane " Rivastela " monté sur un traîneau
standard est retenu par un M 29 à l'arrière car
le cheminement s'effectue sur de la glace vive. Afin d'éviter
cette zone dangereuse qui plus est amputait la mission de jours
précieux, la mise en place c'est effectuée par
avion C 130. |
|
Déchargement d'une
caravane d'un C 130 Hercules de USARF Stratégique Air Command
sur l'Inlandsis à DYE II (Dye II un des nombreux radars implantés
au Groenland au moment de la guerre froide ). |
 |
| Photo J. Masson |
|
|
|
|
Voir
les moyens techniques employés et les conditions d'utilisation
|